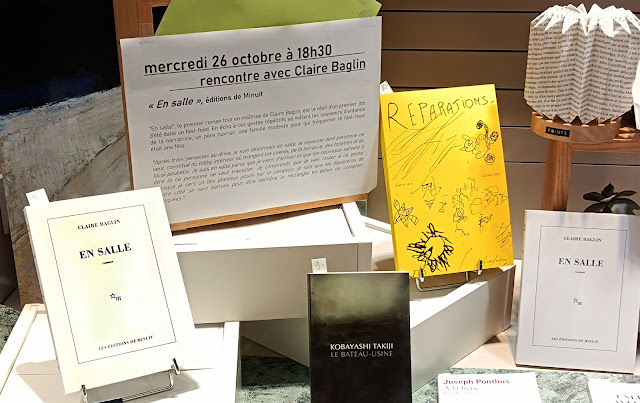Un paysage de la voix
"Il se trouve que ce sont des textes qui racontent des histoires, avec cette idée de la nouvelle - la nouvelle avec son acception de genre : un texte avec un format court. C'est une forme littéraire que je n'ai jamais explorée. J'ai écrit plutôt auparavant des novellas ou alors des romans brefs. Il y en a eu trois : Ni fleurs ni couronnes, Sous la cendre et Naissance d'un pont, et peut-être des récits courts comme Kiruna ; et sinon je n'ai jamais écrit de texte bref, un texte de quinze mille signes par exemple.
Dans ce livre sont rassemblés des textes et les formats sont modulés. On n'a pas appelé ça "nouvelles" parce que, précisément, au milieu d'eux - il y a huit textes dans ce livre - il y a un gros texte central qui, effectivement, pourrait-être un court roman. C'est ce texte de cent mille signes qui est un peu hors-genre et qui fonctionne comme une planète autour de laquelle graviteraient sept autres textes, un peu satellites, qui sont, eux, tous brefs.
L'idée - c'est pourquoi je parle de roman en pièces détachées- c'est que l'on puisse lire chacun de ces textes de manière totalement indépendante. On peut en lire un, s'arrêter là, avoir envie de les lire tous... il n'y a pas vraiment d'ordre non plus. On démarre pourtant dans la préhistoire et on finit dans ce qui pourrait être de la science-fiction, en tous cas des images du futur : des fusées, le GEIPAN (Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés), etc. Néanmoins c'est une forme totalement libre. C'est un livre qui est comme une installation, qui ne correspond pas à un genre précis.
Du coup, comment est-ce que l'on appelle ce livre? On a préféré mettre "récit" parce qu'il y a cette nouvelle centrale, qui est davantage un récit qu'une histoire, au sens où c'est un livre qui comporte pas mal de motifs autobiographiques : cette nouvelle centrale, c'est vraiment mon premier texte autobiographique, même s'il y a de petites échappées de fiction, néanmoins c'est un texte autobiographique. Et autour, on trouve des motifs autobiographiques. C'est aussi pour cela que je parlais de roman. Ce n'est pas du tout l'idée que : "Oh la la, les nouvelles, ça ne se vend pas! On ne va pas mettre que ce sont des nouvelles!". Ce n'est pas vrai. La forme du livre était déjà assez libre, était un peu étrange, et voilà, il y avait cet espèce de petit roman entouré de ces nouvelles, et surtout tout est unifié par cette voix narrative, qui est un "Je" narratif - qui n'est pas tellement une voix narrative que je pratique. C'était une fois, récemment, dans un essai, A ce stade de la nuit, qui est plus une prise de parole. Sinon j'écris plutôt des romans à la troisième personne du singulier, avec un narrateur omniscient. Là c'est un "Je", qui court sur les huit textes. Dans un des huit textes, c'est un "Je" masculin, sinon c'est toujours un "Je" féminin. Il y a des voix féminines : quand la voix masculine parle, elle parle de voix féminines. Et pour le coup, j'avais le sentiment que ces textes, ensembles, débouclaient un espace de roman. Pour moi on est dans un espace romanesque, les textes se parlent entre eux, ils ont des rapports entre eux, et si on veut les lire indépendamment, moi je défends l'idée de les avoir écrits non seulement les uns après les autres, mais dans une continuité de temps assez réduite. Dans ce sens, c'est intéressant aussi : les recueils de nouvelles peuvent être des collections de textes que l'on porte pour dix ans. Vous voyez, un auteur écrit beaucoup, parfois ce sont des textes parus dans des revues, et à un moment on les rassemble et on voit un peu ce que cela donne. Et souvent ce sont des histoires hétéroclites, il n'y a pas forcément d'unité, l'exploration est très vaste. Mais pour moi, ce n'est pas ce que je souhaitais écrire, plutôt un livre où les textes sont tous connectés entre eux, tous raccordés à la nouvelle centrale qui raconte la période où j'ai écrit mon premier livre aux Etats-Unis. Et pour moi c'est cela qui était intéressant, de travailler une forme littéraire assez hybride. Je savais que cela allait être un peu compliqué à définir et on a mis "récit" parce que, de fait, ce texte central tient plus du récit que de l'histoire : c'est vraiment le "Je"."

Histoires de voix
"Ce motif de la voix est là depuis longtemps, je la raccorde à l'oralité dans la littérature. La voix a été tout de suite très importante pour moi, aussi parce que j'ai comme pratique de lire les textes lorsque je les écrits, donc d'inscrire du "lire à voix haute" dans l'écriture. Cela marche ensemble, cette idée de lire à voix haute ces textes, de les dire, de les porter par ma voix et de les écrire. Dans la façon dont les textes se mettent en place et avancent et se créent, il y a cette voix qui rentre dans le jeu, et aussi cette idée qu'il y a une chose très mystérieuse pour moi dans la littérature, et dans l'acte de lire, et dans l'acte de lire en silence, c'est qu'il y a une voix quand même, on entend une voix. Et c'est vrai qu'en parlant un peu du livre, je me suis dit qu'au fond, c'est vrai, lorsqu'on lit dans sa tête on entend une voix qui n'est jamais évidemment celle de l'auteur, que l'on connaît peu. Il y a des auteurs qui s'expriment beaucoup, Marguerite Duras, par exemple, avec cette voix tellement particulière, sinon on n'entend pas la voix de l'auteur. On n'entend pas du tout non plus sa propre voix. Il y a une voix qui est là.
C'est quoi cette voix, qui est là dans les textes? C'est vrai que c'est une question assez énigmatique qui m'intéresse depuis longtemps. Je trouve aussi que cette question de l'oralité me reconnecte à quelque chose d'important pour moi. C'est le fait que, à voix haute, les textes n' ont tout d'abord pas été lus en soi mais depuis les estrades dans les abbayes, comme des prêches, dans les cantines des monastères... On lisait à voix haute à des fins d'édification, des textes souvent religieux, des textes qui avaient une dimension sacralisée., et puis, à un moment, la fiction s'invente en même temps et la lecture pour soi s'invente. Là, il y a un mouvement qui est complétement fascinant et pour moi, cela circule et travaille totalement la littérature au sens où, quand on y pense, la littérature a d'abord existé, non pas sous la forme de textes, mais sous la forme de voix qui disaient des textes à voix haute, dans les villages, sur les parvis des églises, dans les îles grecques... et la communauté convergeait vers ces voix. Il y avait l'idée de faire cercle et de faire du commun avec des histoires qui prenaient des dimensions de mythes.
Vous voyez, pour moi c'est assez important, et donc ça traînait depuis longtemps cette histoire de voix comme motif. Et c'est vrai qu'elles sont toutes venues dans ce moment particulier du confinement où, finalement, on était totalement séparé du corps des autres, hormis peut-être ses plus proches... Il y avait ce fameux truc qu'est le téléphone. On était évidemment pas tout le temps devant les ordinateurs, en revanche on était beaucoup au téléphone, des conversations parfois très longues, et finalement c'était ces voix qui étaient tout le temps là, qui revenaient, les voix des radios... C'est un motif qui s'est cristallisé. Je me suis dit : voilà ! J'avais commencé quelque chose que j'ai cessé de faire au moment du confinement, il y a eu une période de flottement, et finalement à la sortie, en avril-mai, au moment où cela s'arrêtait, je me suis dit : Mais oui, je voudrais écrire sur les voix!
J'ai tenu les engagements pris pour trois textes qui ont été publiés, qui sont repris dans Canoës, et j'ai écrit tous les autres dans le second semestre de 2020, dans un moment où je trouvais justement qu'il y avait une grande intensité des voix humaines et puis surtout ce virus, qui venait finalement se placer sur la trachée-artère... Et puis après il y a eu les masques qui sont venus occulter les bouches, "élastiquer" aussi la mâchoire, et moi j'étais beaucoup sur ces histoires de voix articulées : comment est née la voix humaine? Ce qui nous a permis de parler comme des humains et finalement de faire sécession des autres animaux... Alors ces élastiques, ces voix qui étaient un peu parasitées, même si finalement on peut se parler avec des masques, visuellement les bouches ont disparues. Et ce virus venait se placer sur les poumons, la respiration, le fait d'être essoufflé... Or la voix ce n'est que du souffle qui fait vibrer les petits plis vocaux dans le larynx.
Et ces voix, elles sont venues comme ça, et alors comment les faire apparaître? J'ai essayé vraiment de les regarder à la fois comme des organes, des muscles, dans ce qu'elles ont de physiques, donc il y a une physicalité de la voix : la voix s'altère, elle se modifie, elle peut porter parfois des traces, elle peut être comme une empreinte, etc. Mais c'est aussi bien plus que cela. C'est l'irréductibilité de chaque être humain. Chaque être humain possède sa voix, à l'instar des empreintes digitales. Et j'ai appris depuis - je ne le savais pas quand j'ai écrit le livre - que les systèmes de biométrie vocale sont utilisés pour sécuriser les paiements en ligne, comme il y aurait par exemple de la reconnaissance faciale. Et dire que l'on a chacun la nôtre, c'est déjà très intéressant, c'est fascinant de penser qu'il y a sept milliards et demi de voix sur terre, qui pourraient fonctionner comme des empreintes de ces êtres et aussi que, aucun de ces sept milliards et demi de personnes n'a accès à sa propre voix quand elle n'est pas sonorisée par un micro. C'est-à-dire que moi je vous entends mais vous, vous ne vous entendrez jamais comme je vous entends. Il y a ce truc complétement dingue : la dissociation. C'est-à-dire que la voix que j'entends comme étant la mienne, ça m'est arrivé de l'entendre à la radio, quand je l'entends avec un micro, tout à coup il y a une espèce de dissociation et personne, finalement, n'a accès à ce qui le distingue d'entre sept milliards de personnes. Il y a une espèce de dissymétrie, de paradoxe.
Et j'ai eu envie, ces voix, de les qualifier, de les spatialiser, d'en faire aussi, presque, des territoires, parce qu'elles ont une matérialité et aussi cette autre chose qui est de l'ordre de l'immatériel. C'est cela qui est beau avec la voix : il y a à la fois la tessiture, le grain... et puis il y a la vibration, la rémanence et le fait que cela fait revenir : on entend une voix et les choses reviennent, cela se réimpose, on a une dimension de souvenir. Cela pourrait être un motif, un sujet qui est très littéraire, quand on parle des grandes voix d'aujourd'hui, la voix des poètes... Quand on regarde bien ce qu'il y a derrière ce terme de voix, c'est immense. Et j'ai d'ailleurs le sentiment de commencer, vous voyez, c'est un livre qui a ouvert un champ Pas du tout le sentiment d'avoir fait le livre sur la voix mais d'avoir ouvert , de m'avancer vers quelque chose qui pourrait durer encore."
Préhistoire
"C'est quelque chose qui a pris beaucoup d'importance. Je pense qu'avec cette histoire de coeur humain dans Réparer les vivants, j'ai fait quand même un livre où il y avait une dimension anthropologique, qui regardait le corps, beaucoup, et puis après j'ai écrit un livre sur une fille qui apprend à peindre, mais aussi qui se pose des questions : c'est quoi inventer? C'est quoi refaire? Et qui se retrouve dans une grotte, le fac-similé de la grotte de Lascaux. Et c'est vrai que, pour moi, il y avait là, dans la préhistoire, une dimension énigmatique qui me bouleverse, et aussi il y a la fugacité des traces, parce qu'il y a beaucoup de choses finalement... des traces qui ne sont lisibles d'abord que par de grands savants. La lecture scientifique des traces de la préhistoire demande des compétences très importantes. Parfois on a tendance à se projeter, à un moment de l'histoire, la fiction est possible. C'est un lieu de projection qui est très fort, un imaginaire qui est très fort.
Et c'est vrai pour la voix humaine, on n'a pas toujours parlé comme on parle. Et moi j'aime assez prendre la littérature, prendre les livres par ce biais-là, me dire : voilà, comment ça se passe? Et ça fait venir beaucoup de choses. D'abord regarder anatomiquement comment cela fonctionne, aussi comment cela se modifie, le rapport aux souvenirs... et c'est vrai, quand on regarde la première nouvelle, c'est un recueil qui commence par des travaux dans une bouche. On prend des empreintes dans une bouche : c'est une prise d'empreintes, c'est pas mal déjà, les cordes vocales sont déjà des empreintes, au sens où, si quelqu'un est déprimé, sa voix peut s'assombrir, s'il est très heureux elle peut être très aigüe, ça change. Donc la voix est une empreinte de notre vie et là, l'empreinte est dans la bouche.
Et ça faisait des petits fac-similés de bouche, comme on en voit tout le temps chez les dentistes, ces petites dents, parfois colorées en plâtre rose ou bleu, et c'est vrai que cela coïncidait avec cette histoire de mandibule retrouvée dans le XVe arrondissement, et qui est une histoire dingue, quand même! Pour avoir été sur un chantier de fouille du paléolithique supérieur, pour avoir été acceptée par des préhistoriens sur un chantier archéologique, d'archéologie scientifique, on ne voit rien en fait, les traces sont tellement ténues, tellement fugitives, ce sont des micro-bouts de silex... Et on projette, et la pensée est immense. Et on peut essayer de reconstituer des foyers : cela, par exemple, cela vient, je ne sais pas, d'Aquitaine et puis cela, ça vient plutôt de l'Hérault, ce ne sont pas les mêmes cailloux, les mêmes rivières, donc ils étaient en contact... Moi, tout cela, ça me passionne totalement, ça m'envahit beaucoup. Et je me suis dit : comment parlaient les gens de la Préhistoire? Evidemment ils ne parlaient pas comme nous, mais évidemment qu'ils ne poussaient pas des cris non plus. Vous voyez, la naissance du langage, je trouve cela hyper-émouvant, rien que d'en parler ça me touche!
Et il y a aussi des petites choses dans la vie, le fortuit... J'ai lu par exemple - c'est assez admis - que si le larynx n'était pas descendu, au niveau de la cinquième vertèbre, on n'aurait jamais parlé. On aurait parlé comme les singes parlent, c'est-à-dire les caquètements, les cris, les borborygmes, les hurlements, les appels, des formes de vocalisation qui sont parfois hyper-sophistiquées. L'Homme est d'abord celui qui possède le langage articulé et aussi celui qui contrôle ses émissions vocales, c'est quand même cela qui le distingue. C'est pour cela que le cri, c'est génial, c'est ce qui nous ramène à notre part animale, c'est ce qui nous échappe, ce que ne contrôle pas. Le cri de surprise nous rabat sur notre animalité. Le cri, c'est intéressant. De fait, on n'a pas le droit de crier en société, on crie dans les salles etc. Mais c'est marrant de se dire que le cri a été banni de notre société parce que, probablement, c'est notre part animale qui s'exprime, sauf dans les moments de liesse, les moments où, justement, où on aurait le droit de se lâcher."

Phonétique
"Je me suis beaucoup intéressée à la phonétique pour écrire ce livre : comment est-ce que l'on décrit une voix? Il y a une nouvelle qui met justement en rapport un cri et un bégaiement. C'est une jeune fille qui est bachelière, il y a une fête dans une prairie et il y a cet espèce de cri qu'il faudrait pousser puisque le bac est un peu ce rite de passage et on pourrait naître autrement après... Il y a l'idée que cela bouge, cela change. Ils vont pousser des cris et cela se met en balance avec le frère de la narratrice, qui est un jeune homme, qui est bègue et qui, lui, n'arrive pas à parler. Et c'est vrai que dans le bégaiement, qui est aussi un terme très littéraire, de critique littéraire - on pense immédiatement à Deleuze, le bégaiement de la langue, faire bégayer la langue, ces grands textes de critique de littérature - il y a aussi le fait de faire revenir, il y a quelque chose qui n'advient pas... de l'impossibilité aussi de l'appareil neuronal mais aussi parfois le rapport strictement émotif au bégaiement, il y a les deux. J'essayais un peu de les mettre en rapport et la phonétique m'aidait beaucoup, ne serait-ce que pour comprendre un peu comment cela fonctionne.
C'est un livre où il y a moins de charge documentaire que dans mes autres livres, mais surtout moins que dans Un monde à portée de main, c'est un livre un peu plus pensif, un livre où je fais revenir beaucoup de choses, jusqu'à faire revenir ce moment où, moi, j'ai écrit, j'ai capté ma fréquence à moi. Mais, par ailleurs, il y a quand même une façon de travailler qui me conduit toujours à aller vers un livre de phonétique par exemple, à un moment donné, tout cela m'a pas mal intéressé."
Boîtes à histoires
"L'exergue d'Ursula K. Le Guin, je l'ai posé après mais je connaissais ce texte. J'explique rapidement ce que c'est : c'est un texte assez culte. Ursula K. Le Guin, c'est une auteure de science-fiction, américaine, qui est en train de devenir un peu la figure de proue de l'écoféminisme américain. Elle a écrit un texte assez génial qui s'intitule La théorie de la fiction-panier où elle fait une théorie qui passe par un récit, elle raconte sa théorie. Elle pose l'hypothèse que le premier artefact qui aurait été construit par l'humanité aurait été un récipient : un contenant, une calebasse, une écharpe, comme il y a des porte-bébés, un bol, parce qu'il allait falloir rapporter chez soi ce que l'on a glané alentour, autour du camp. Chez les chasseurs-cueilleurs, on se déplace, on est nomade et puis, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas parce que l'on a retrouvé de silex et des pointes de flèches que les populations, et plus majoritairement les hommes, étaient des chasseurs. Il y avait un petit peu de chasseurs mais beaucoup de cueilleurs, les gens passaient leur temps à glaner, d'où l'invention de ce récipient. C'est assez beau cette idée : on rapporte chez soi ce que l'on a été glaner alentour.
Et je raconte ce moment où ce voyage change ma vie. Dans cette espèce de dépaysement, il se passe que j'écris un roman. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout un texte où il y a une mise en scène du passage à l'écriture, ça je pense que c'est impossible : "Et je me suis mise assise, et j'ai écrit...", non, c'est impossible! Mais, en revanche, il y a ce truc que j'aime bien raconter, la phrase de Bernard-Marie Koltès : quand je suis triste, je n'écris pas "Je suis triste", j'écris "Je vais faire un tour". Alors quand je voudrais raconter que j'ai écrit, je ne dis pas : "J'ai raconté que j'ai écrit", je raconte : "J'ai passé mon permis de conduire". Ou alors j'ai pensé que je n'allais pas m'adapter et j'ai pensé à la disparition des dinosaures... Et c'est vrai que cette histoire de la "Fiction-panier", quand j'ai lu le texte, je l'ai trouvé assez géniale, mais surtout il y avait cette idée de concevoir les romans, et peut-être donc les canoës, et peut-être les livres, comme des contenants, comme étant des paniers eux-mêmes, que les livres sont comme des boîtes à histoires. Et j'ai trouvé que c'était totalement connecté à ce que j'étais en train de faire. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas voulu illustrer cette théorie d'Ursula K. Le Guin, mais quand, à la fin, moi j'ai mon histoire de bol, tout s'est reconnecté. D'ailleurs il y a une autre allusion qui est pour elle, sur les paniers, les paniers des indiens, qui dit aussi quelque chose de leur culture."

Analogies
"C'est vrai que tous les textes, particulièrement Mustang, parce qu'il est autobiographique - et qui est un texte où, à la fois, je savais ce que j'avais envie de raconter, ce semestre d'automne aux Etats-Unis, et donc je sais tout de même où je vais, je sais que ça va être cela, mais, en revanche, ce qui s'active beaucoup dans ce livre-là, un peu dans le précédent Un monde à portée de main, mais de plus en plus, c'est l'idée que écrire des textes d'imagination, c'est toujours faire des analogies. C'est-à-dire qu'imaginer, ce n'est pas "Ah! J'ai trouvé un truc très très original à raconter!", ce n'est pas ça l'imagination. L'imagination, c'est un travail qui consiste à connecter les choses entre elles et c'est faire de l'analogie. Et là, par exemple, dans Mustang, tout fonctionne comme cela : l'adaptation, la peur de disparaître, les dinosaures, la voix qui change, cette femme, cette narratrice qui est assez déstabilisée, qui est inquiète, et puis, tout d'un coup, cette fille qui commence à chanter dans la bagnole et qui s'entend, entend sa voix dans l'habitacle, etc. Je trouvais que c'était pas mal. Et ce passage un peu à l'acte, c'est aussi le fait que, quand je suis rentrée en France, quelque chose s'était modifié pour toujours, enfin, jusqu'ici.
Je l'interprète comme une écriture qui se détend un peu, au sens où j'écris des romans très actifs, il faut qu'il se passe des choses, on apprend des choses, on crée des choses, on transplante, on construit, on apprend, on refait... Il y a du monde, ce sont des romans qui mettent en place pas mal de gens, et là, c'est l'inverse : c'est une fille assez solitaire, qui ne fait pas grand chose. Et dans les autres textes on retrouve aussi cette idée de moments de vulnérabilité, y compris cette fille qui assez est déstabilisée par cette histoire de mandibule, cette autre qui revoit son amie et qui est troublée par le fait qu'elle ait pris un coach vocal pour baisser sa voix, parce qu'à la radio les voix de femmes aigües sont mises sur le côté, enfin ces femmes-là n'ont pas accès à l'information, elles ne peuvent pas s'épanouir en tant que journalistes : on pense que la voix aigüe connote trop la fragilité, l'hystérie... La voix plus grave, c'est une voix qui rassure, qui pose les informations... il y a une controverse. Une petite fille aussi va enregistrer une nouvelle d'Edgar Poe - et pas n'importe quelle nouvelle! Il y a un oiseau justement, les oiseaux étant les plus proches de nous sur le plan vocal, là il faut lire le livre de Vinciane Despret (Habiter en oiseau, Actes Sud, 2019). C'est un texte d'Edgar Allan Poe, Nevermore, traduit par Baudelaire, avec ce corbeau qui parle - elle est dans un moment de fragilité, elle comprend que sa voix porte la trace d'une blessure ancienne... Il y a la voix de cette femme qui est morte et qui reste sur le répondeur familial, et qui est aussi une histoire d'oiseau. Les nouvelles sont connectées entre elles sur le plan des analogies : on retrouve un enfant, du chocolat noir, les dinosaures, des oiseaux, un certain rapport au liquide, à la fluidité, les canoës, etc. Et à l'intérieur de chaque texte, cela re-fonctionne un peu comme ça, une manière de dire que c'est moins l'imagination que poser un imaginaire. C'est un imaginaire dont on peut repérer, finalement, les éléments qui le constituent, qui infusent ensemble.
Et cela, c'est quelque chose qui me donne pas mal de joie, quand j'arrive à reboucler... C'est le moment où le texte vous surprend. Cela s'est produit beaucoup dans Un monde à portée de main, mais à postériori, il y a des réseaux qui se mettent en place. Dans Réparer les vivants aussi, il y a des différents réseaux qui se mettent en place. Là, c'est vrai que j'étais à l'écoute de cela et quand j'arrivais à ce que quelque chose se renoue, notamment dans Mustang... Même la question de l'adaptation, qui est une grande question de préhistoriens, la retrouver dans le livre... Et le bol final, pour le coup, j'étais extrêmement émue! Parce que c'est vrai que j'ai fait trois choses aux Etats-Unis : j'ai appris à chanter, j'ai appris à conduire et j'ai fait quelques bols - je n'étais pas très douée mais je les ai ramenés chez moi. Tout cela au sens où tout est exact, et du coup je trouve que cette façon d'écrire par analogie, par signes, écrire dans la résonance, ça me touche énormément. Quand ça arrive, c'est un cadeau de la phrase, un cadeau de la page, un cadeau de cette journée! Ce ne sont pas des choses que l'on peut s'acharner à produire, mais quand elles viennent, j'ai toujours le sentiment que quelque chose s'est produit de juste dans le texte."

Echos
"Je voulais visiter les motifs de la voix enregistrée, que l'on a dans Nevermore et puis la voix sur le répondeur, et puis les voix téléphoniques, qui sont importantes, notamment dans Mustang , les gens au téléphone, la question de la voix des morts... Et quelque chose de très important, c'est de m'être rendu compte que, contrairement à ce que je pensais, ce n'est pas tant les photos, les objets ayant appartenu à des êtres que j'ai aimés et qui sont morts, qui me permettent de toucher ou d'y penser, c'est la voix. En fait, je suis toujours inquiète à l'idée de ne pas garder à mon oreille la voix de personnes qui sont parties, quand je n'ai pas d'enregistrement. Et souvent je les rappelle, quand je pense à elles. La voix, c'est très important, c'est quand même de la présence. Evidemment l'odorat, c'est plus l'organe de la mémoire, qui est encore un autre champ. Mais la voix, c'est la présence. Cela, par exemple, ça sinue pas mal dans toutes les nouvelles, la disparition, la vulnérabilité... puis il y a des motifs beaucoup plus précis. C'était drôle de les re-croiser, comme si ce que j'étais en train d'écrire tout à coup me faisait signe en me disant : mais ça, ça revient. Et quand ça fait retour sous une autre forme, par exemple dans une métaphore, ce système d'échos, quand on l'a dans un livre, j'ai toujours le sentiment que le réseau tient le livre. Pas besoin d'être trop inquiète, la construction, les frontières, finalement, ce réseau rémanent va tenir la forme du livre, il le prend dans sa maille : ces voix qui se croisent, qui se répondent, ces échos, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce livre-là. C'est un livre qui n'est pas très long mais il est riche de cela : tout fait écho."
D'écrire, dit-elle
"Il se trouve que j'ai relu Duras, que j'avais pas mal lue à vingt ans quand même, ce n'est pas un auteur très difficile. C'est un auteur qui a écrit des grands romans aussi, et je sais que vers vingt ans j'aimais ses livres. Et là, à cette période, j'ai eu envie de relire Le marin de Gibraltar, Un barrage contre le Pacifique, des livres que j'aime beaucoup, et aussi des textes d'elle plus théoriques... enfin, plus théoriques... elle ne fait pas tellement de théorie d'ailleurs, c'est une poète, il y a des moments où elle s'exprime plus comme une poète... Mais ce qui a été important pour moi - ce livre en fait la trace mais en fait tout mon travail porte cette trace-là, qui s'est beaucoup intensifiée avec Un monde à portée de main, mais peut-être un peu avant avec déjà Réparer les vivants - c'est la question de la description. C'est-à-dire la question de la description comme un usage littéraire. Alors, justement, ne pas en faire la pose, dans le récit - ni d'ailleurs dans les deux sens : prendre une pose, ou une pause, on s'arrête - mais en faire le moteur de la narration. Faire qu'écrire cela soit activer l'action, la narration etc. Et ne pas toujours s'en remettre aux dialogues, on va très vite... Mais prendre le temps de regarder. Ce que j'aime dans la description, c'est que c'est immédiatement la durée. Quand on décrit, on passe dans une durée qui fait forcément sécession avec la durée qui est celle de nos vies, où l'on va vite. Là, on décrit, c'est un autre rapport : on regarde, on observe et surtout, ce que j'essaie de dire dans ce texte (paru dans La Revue du Crieur 17, novembre 2020), on essaie de distinguer.
Ce qui est important, ce qui est génial, ce que moi je mets dans la description, c'est l'idée que l'on est dans une époque, précisément, où les choses s'accélèrent. Bon, ce sont un peu des truismes, on va pas y passer des heures mais c'est vrai que ça va vite et on ne cherche plus son mot, d'une certaine manière. C'est de l'information en boucle, les chaînes d'information "en continu"... et on a l'impression que les personnes qui parlent, je le ressens comme cela, les hommes et les femmes, en politique, on est "en continu" : les gens parlent avec des tirets entre les mots et on ne cherche plus son mot. Je trouve cela assez violent. On a pas le temps de spécifier, de distinguer, de caractériser, de singulariser, et ça, je trouve que c'est violent. Et je pense que la littérature, là il y a un truc pour moi de la politique de la langue, la littérature est quand même faite pour mettre ça à distance et finalement de se remettre dans un temps, le temps de l'écriture, un temps qui, justement, on cherche le mot juste. Et peut-être que ce bleu là-bas, il n'est pas turquoise, en fait, il est peut-être plutôt myosotis, il est peut-être plutôt bleu roi, mais c'est un bleu turquin, mais oui! Mais c'est un arbre! Mais je le connais!...
La description fait aussi rentrer de l'imaginaire, elle fait rentrer de la matière, elle fait rentrer de la couleur, elle fait rentrer du climat, elle fait rentrer de la physique, elle fait rentrer du sentiment. Et pour moi c'est important, ça me permet de me départir d'un régime de langage qui est celui du langage standardisé, qui l'on peut trouver même dans des oeuvres littéraires, publiées. Je ne dis pas qu'il faut chercher tout le temps, etc. Parfois il faut se relâcher d'une forme de vitesse, mais moi j'ai l'impression d'écrire contre une forme de banalisation, de standardisation de la langue. Pour moi c'est violent que l'on coupe le détail, précisément... D'ailleurs c'est un développement dans cet article sur la description : c'est que le détail, c'est précisément là où va s'accrocher l'imaginaire. Par exemple dans mes livres, en tous cas, et je trouve dans pas mal de livre, les visages, on a du mal à les décrire. Les corps, ça va, mais c'est bizarre, la face, le visage humain - je pense aussi pour des raisons philosophiques - on a du mal à les décrire. C'est rare, et c'est quasiment injouable. Pour un truc avec des amis, on a fait quelque chose autour de Madame Bovary, je l'ai relu... et même, il est toujours sur elle, Flaubert, il la regarde tout le temps, il ne la lâche jamais, jamais. Mais on ne l'a pas vraiment le visage d'Emma, à la fin. On a les bandeaux, on a la pâleur... C'est compliqué. Et le détail, justement, eh bien ce sont les bandeaux noirs, c'est la pâleur. Le détail c'est comme une prise, qui permet de construire le réel, de lui donner une forme.
Quand il n'y a plus de détail, il n'y a plus de singularisation, de personnification. Pour moi ça compte, de faire ce travail de nomination... Il y avait cette traduction du Vieil homme et la mer qui est vraiment géniale, je la cite en conclusion : "A chaque chose un nom, le sien." C'est cette idée aussi d'harmonie, de justesse et que la littérature c'est peut-être le dernier lieu où on peut encore faire ce travail-là sur le langage. Parce qu'ailleurs ce n'est plus possible. On est pris... ça va trop vite : dépêche-toi! c'est trop long! Et même quand on pense aux choses : ce qui est beau quand on écrit, c'est que l'on passe dans un autre temps, un temps quand même bizarre, où on peut se dire : Mais ça c'est quoi? Mais ça vient d'où?... Et le regarder c'est le mettre immédiatement en rapport avec le reste. Le monde se construit et ça, ça reste beaucoup dans ce livre. Et c'est vrai que dans cet article, c'est vraiment le plaidoyer pour ce truc de décrire...
Décrire, c'est les lieux. C'est donner une terre à son texte, un sol à sa fiction. Dans des romans, les personnages hors-sols sont pleins d'idées mais ils n'ont pas froid, ils n'ont pas chaud, ils ne se prennent jamais un mur... Je suis assez attachée à des personnages qui sont raccordés au monde physique et je crois que c'est ce qui me permet d'en faire des êtres de psychologie justement. La psychologie, je vais essayer de la retrouver par ce biais des êtres de sentiments. Je trouve que les choses prennent place quelque part, et cette histoire de la nomination, évidemment, a des résonances politiques pour moi qui sont importantes. J'en parle dans cet article du Crieur, j'avais été très impressionnée, j'avais lu dans La Croix un article sur un photographe extraordinaire qui a fait un reportage en Sicile, à Lampedusa mais aussi à Palerme, sur des gens qui donnent une hospitalité post-mortem aux personnes qui se noient en Méditerranée, et donc qui font ce travail de nomination, de savoir : ils s'appelaient comment? Et retrouver le nom des gens, c'est un travail sur plusieurs mois, qui engage beaucoup de bénévoles. Evidemment, s'il est question de nomination, ce serait comme le Collectif Les Morts de la Rue à Paris, il faut leur redonner une vie et les distinguer. Ce n'est pas "la vague des migrants", "le flux qui nous submerge", tout ce vocabulaire de la liquidité, c'est aller chercher dans la liquidité, reconstruire de la distinction, des vies, des noms. Donc pour quelque chose qui se donne à nous comme des foules, et parfois foules qui nous inquiètent, parfois foules qui peuvent avoir un aspect très impressionnant, justement ce truc de décrire, de spécifier, ça nous rappelle... je trouve que c'est quelque chose de très fort sur le plan politique et du rapport à l'étranger. "

Révélateur
"Il y a l'idée, et ça je ne l'avais pas envisagé avant de me lancer dans ce texte, que la voix révèle en fait beaucoup de nous. J'étais beaucoup plus sur le monde sonore, lien-souvenir, le lien au passé. Dès qu'on est chez soi, dans le silence et quelqu'un appelle - Il y a ça dans Proust - et que l'on ne l'a pas vu depuis dix ans, mais qu'à l'entendre, immédiatement, il se réimpose, c'est cela qui m'impressionnait beaucoup. Et c'est vrai qu'en écrivant je me mettais à penser qu'il y avait cette histoire quasiment photographique, c'est-à-dire qu'il se réimpose, on le voit. Et Proust est génial : à un moment il est au téléphone - je crois que c'est dans A l'ombre des jeunes filles en fleurs - et il invente quand même le smartphone, il y a le portrait, le visage de celui qui lui parle qui apparaît totalement, dans sa voix. Je trouve que la voix joue comme un révélateur et il y a plein d'histoires incroyables que j'ai glanées, des gens par exemple qui recrutent, sont recrutés à l'aveugle, uniquement à leur voix, au téléphone : une voix dynamique, une voix morte, une voix claire etc.
Il y a la voix qui révèle la personnalité puis qui joue aussi, comme on le disait tout à l'heure, l'empreinte, la révélation d'un passé qui revient, qui tremble de nouveau dans une voix qui récite un poème. C'est fort, pour moi c'est un organe extrêmement puissant, qui fait un peu le lien entre les temps, à la fois parce qu'elle peut être enregistrée et à la fois parce qu'elle a ce grain dont on parle et elle fait le lien entre les temps, notamment parce qu'elle peut planer, elle peut envahir l'espace, elle peut être chuchotée. C'est comme une espèce de nappe immatérielle mais qui peut tout envahir et aussi se rétrécir, elle a une plasticité qui est très belle. Je n'ai pas du tout abordé le chant dans ce texte. Je trouve que le chant c'est un très beau sujet, je ne pouvais pas le mettre dedans, ce serait comme un livre en soi... mais j'avais envie de parler de ces voix révélatrices, qui jouent comme des révélateurs."
Et le grain de la voix de l'auteure, pour une petite lecture :
Canoës, éditions Verticales, 2021.