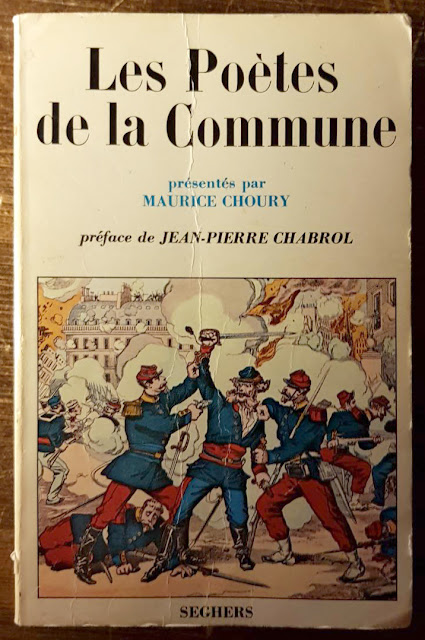Armand Robin
Poète, né en 1912 au fin fond de la Bretagne où l’on ne parlait pas français, il apprend cette langue à l’école. Remarqué par son instituteur, il fait des études, apprend le latin, le grec, l’allemand, l’anglais, puis le polonais, le russe, le hongrois, le finnois, l’arabe, le chinois…
En 1934, il fait un voyage en URSS, et comprend que le paradis prolétaire est une immense duperie. Il écrit un admirable texte relatant cette désillusion, « Une journée », paru dans la revue Esprit, en 1937. En voici un extrait :
« Nous ne savons pas qui dirige le monde : fascisme et communisme se reprochent mutuellement d’être le valet du capitalisme ; il y a bien des chances qu’ils le soient tous les deux ; il n’est même pas sûr qu’une vraie « dictature du prolétariat » ne puisse être le régime idéal pour le grand capital, la « prolétarisation » de toute la société faisant disparaître le petit capital et le capital moyen et abolissant ainsi l’indépendance d’une partie de la richesse terrestre. D’ailleurs le grand capital, du moment qu’il existe, doit par définition tendre à raréfier suffisamment la richesse du monde pour rester seul muni d’armes ; il est normal aussi qu’il accapare jusqu’aux leviers de commande de ses ennemis, qu’il arrive à se servir d’eux à leur insu, ou même qu’il crée et entretienne lui-même tout ce qui s’opposera à lui ; la protestation contre le capitalisme serait ainsi organisée par le capitalisme lui-même dans les limites qui lui conviendraient. »
Dès lors, il sera un antistalinien convaincu, comme Breton, Péret, Malaquais ou le poète Maurice Blanchard.
Pendant la guerre, mettant à profit son don pour les langues, il rédige un bulletin d’écoutes radiophoniques utilisé aussi bien par les ministères, les administrations et les journaux que par la résistance. Dénoncé aux autorités d’occupation, il écrit à la Gestapo, en 1943, avant de cesser son activité :
« Preuves un peu trop lourdes de la dégénérescence humaine,
Il m’est parvenu que de singuliers citoyens français m’ont dénoncé à vous comme n’étant pas du tout au nombre de vos approbateurs.
Je ne puis, messieurs, que confirmer ces propos et ces tristes écrits. Il est très exact que je vous désapprouve d’une désapprobation pour laquelle il n’est point de nom dans aucune des langues que je connaisse (ni même sans doute dans la langue hébraïque que vous me donnez envie d’étudier). Vous êtes des tueurs, messieurs ; et j’ajouterai même (c’est un point de vue auquel je tiens beaucoup) que vous êtes des tueurs ridicules. »
Pris pour fou, il n’est pas inquiété, mais se retrouve, à la Libération, inscrit sur la liste noire du Comité National des Ecrivains, à la demande d’Aragon, pour « trotskisme ». Il réplique par une lettre : « Je vous écris cette lettre pour vous dire que j’exige de rester sur cette liste noire ; même si vous désirez en retirer tous les noms, j’exige d’y rester, seul, je prendrai toutes mesures pour obtenir que cet honneur, que vous m’avez inconsciemment fait, reste un acquis pour le reste de ma vie. »
Après la guerre, il collabore au Libertaire, où il croise Camus, Brassens, Ferré, Breton, Péret et d’autres. Il reprend ses activités de traducteur, en particulier des poètes russes : Blok, Essénine, Maïakovski, Pasternak, mais aussi Rilke, Mickiewicz, Endre Ady et Attila Joszef (deux poètes hongrois), Omar Khayyam, Goethe, Shakespeare, et d’autres moins connus.
Sa fin sera tragique et mystérieuse : arrêté dans des circonstances jamais élucidées, il meurt à l’infirmerie du Dépôt de la préfecture de Paris, le 30 mars 1961. Ses amis sauvent ce qui peut l’être de ses écrits.
Il est auteur de poésies (Ma vie sans moi, Poèmes indésirables) dans lesquelles il inclut ses traductions, les considérant comme son œuvre, d’un roman (Le Temps qu’il fait) qui mêle poésie, théâtre et récit en prose, et d’essais (La fausse parole, Le combat libertaire) ; de nombreux textes sont inédits ou introuvables.
Par Etienne